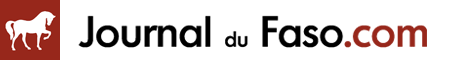Officiellement, le pays est devenu indépendant le 13 août 1960. Mais pour de nombreux Centrafricains, c’est le 1er décembre 1958, date de la proclamation de la République, qui symbolise l’indépendance.
Chaque 13 août, les Centrafricains fêtent leur date d’accession à l’indépendance. Une journée qui donne lieu à quelques commémorations et des commentaires de fierté sur les réseaux sociaux. Mais même si pour la première fois, l’année dernière, un défilé militaire s’est déroulé ce jour-là, les autorités préfèrent célébrer le 1er décembre. À cette date, tous les corps constitués de la société centrafricaine défilent devant le président, et de nombreuses cérémonies ont lieu à travers le pays.
« Nous sommes les seuls qui célébrons deux fois l’indépendance dans l’année », confirme Bernard Simiti, professeur d’histoire et chercheur à l’Université de Bangui, et ancien ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur. Pour mieux comprendre, il faut se replonger près de 73 ans en arrière. Le « Oui » l’emporte très largement lors du référendum sur l’indépendance du 28 septembre 1958, dans les anciennes colonies françaises de l’Afrique équatoriale française (AEF) et de l’Afrique occidentale française (AOF).
République centrafricaine
Dans la foulée, Barthélémy Boganda, ancien prêtre devenu député, promoteur de l’indépendance en Afrique centrale, propose à ses pairs de l’AEF de créer un vaste ensemble fédéral regroupant les quatre pays qu’il propose d’appeler République centrafricaine. Mais ce rêve panafricain se heurte au refus de ses homologues, qui, « travaillés par la métropole » selon Bernard Simiti, refusent cette union.
Par dépit, Barthélémy Boganda proclame alors, le 1er décembre 1958, la création de la République centrafricaine, limitée aux frontières de l’ancien territoire de l’Oubangui-Chari. Il met en place les institutions et dotera d’un hymne et d’une devise ce nouveau pays dont il est le premier président éphémère. Il meurt en effet officiellement dans un accident d’avion le 29 mars 1959, dans des circonstances qui demeurent toujours troubles. Son neveu David Dacko le remplace à la tête du gouvernement de la République centrafricaine. Il en devient le premier président l’année suivante au moment de son indépendance.
« Si Boganda n’avait pas disparu, selon moi, le 13 août n’aurait pas existé, poursuit le Pr. Bernard Simiti. Le 13 août faisait en effet partie de l’agenda de De Gaulle et Barthélémy Boganda ne voulait pas de ça. Pour lui, le 1er décembre était l’aboutissement de la lutte politique, et une manière de dire à ses pairs africains : ‘L’Union que je vous ai proposé et que vous avez refusé, et bien vous vous en souviendrez’. « Aujourd’hui, ajoute-t-il, amer, je crois que Barthélémy Boganda doit se retourner dans sa tombe. Depuis l’indépendance, il y a eu la création de la CEEAC et d’autres organisations régionales. Ce sont les idées revisitées de Boganda en quelque sorte. »
Jeune génération
Mais avec le temps, la perception du 13 août évolue au sein de la société. Rosmon Zokoué, le président de l’Association des blogueurs centrafricains (ABCA), le confirme : « Pour nous, la jeune génération centrafricaine, c’est plutôt la date du 13 août qui est la plus importante. C’est à cette date que nous sommes réellement devenus un pays indépendant. Et c’est cette date-là qui compte. Pour nous, le seul fait déjà d’être libres, et d’être dans une République, c’est très important. »
L’ABCA organise d’ailleurs ce 13 août une table ronde pour le compte de l’ONG panafricaine de blogueurs Africtivistes, autour de la justice et de la violence politique en Centrafrique. Pour Rosmon Zokoué, l’utilisation du 1er décembre par les autorités est clairement le fruit d’un calcul politique. Une façon de s’attribuer la mémoire de Barthélémy Boganda.
« Mais, insiste-t-il, le pays est divisé justement parce que l’héritage de Boganda, n’a pas été bien géré par la vieille génération. Il y a aujourd’hui des chiffres alarmants. Des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés, presque 2,7 millions de Centrafricains qui sont en état d’insécurité alimentaire. Tout cela ne laisse pas indifférent vis-à-vis de tous les combats que Barthélémy Boganda avait essayés de mener. Avec les moyens légaux, je précise. »
Transmission
Plus qu’une question de célébrations, c’est donc surtout la question de la transmission de son œuvre politique qui doit être enseignée. « Pour que les valeurs que le père de l’indépendance a voulu transmettre au peuple centrafricain en général ne soient pas oubliées, poursuit le président de l’ABCA, il nous faut vraiment faire un travail de mémoire autour de son héritage, à travers ses maître-mots : Unité, Dignité, Travail [devise centrafricaine, NDLR]. »
Bernard Simiti l’admet, cette ambivalence de dates est bien également une question de génération. « Pour les jeunes, le 13 août compte. C’est une date importante. C’est ce jour-là que la RCA est devenue membre des Nations unies et a été reconnue sur le plan international, précise-t-il. Mais pour les Oubanguiens, c’est à dire ceux qui sont nés avant l’indépendance, c’est le 1er décembre. Étant donné que le 1er décembre est entré dans les mentalités des anciennes générations, c’est difficile de leur retirer ça aujourd’hui ».
Le professeur ajoute néanmoins un dernier argument, qui pourrait faire la différence : « On pourrait transférer les festivités du 1er décembre au 13 août, mais les autorités expliquent qu’au moins d’août, c’est un mois pluvieux, donc la pluie risque de gâcher la fête, contrairement au 1er décembre où nous sommes en saison sèche. »
Néanmoins, il reconnaît que les choses évoluent. « L’année dernière, il y a eu un début de festivités avec un grand défilé militaire qui a été organisé le 13 août. Les deux dates sont importantes pour la RCA, et c’est devenu une tradition. »