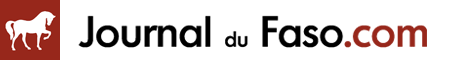Dans les allées encombrées du marché de Kidjigira, les clients de toutes confessions se bousculent désormais sans crainte au milieu des fumées des marmites en suspension et des nuées de mouches. Il y a peu, l’endroit était encore un no man’s land séparant les quartiers musulman et chrétien de Bambari, épicentre de la guerre civile à son paroxysme en Centrafrique entre 2013 et 2017.
Les affrontements ont cessé depuis 2018. A trois semaines d’élections présidentielle et législatives sous haute tension, cette ville située au cœur d’un pays parmi les plus pauvres du monde se veut l’emblème de la réconciliation entre les communautés qui se sont déchirées, une « cité pilote » où bailleurs de fonds internationaux et humanitaires ont concentré leurs efforts depuis 2017.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
Mais en dépit des millions déversés, le chômage et la misère persistent et comme dans le reste d’un pays occupé aux deux tiers par les groupes armés, l’avenir est lourd d’incertitudes.
Bambari fut longtemps coupée en deux et ravagée par les combats entre groupes armés musulmans de l’ex-Séléka, coalition qui avait renversé le président François Bozizé en 2013, et milices chrétiennes et animistes antibalaka.
Les commerçants sont assis devant leurs magasins à Bambari, en République centrafricaine, le 18 novembre 2020.
Les commerçants sont assis devant leurs magasins à Bambari, en République centrafricaine, le 18 novembre 2020.
La ville semble apaisée aujourd’hui. Mais ce n’est pas le cas de tout le pays car, en dépit d’un accord de paix signé par 14 groupes armés et le gouvernement en 2019, les milices s’affrontent sporadiquement dans de nombreuses régions et commettent des exactions contre les civils, entretenant le sentiment d’insécurité.
A Bambari, chrétiens et musulmans arpentent librement les rues. Un à un, les bâtiments ruinés par des décennies d’abandon de l’État puis de combats se couvrent de peinture fraîche.
« On se réjouit du retour à une cohabitation pacifique, mais c’est fragile parce que ça dépend aussi de l’économie », s’inquiète Jeannot Nguernendji, président du Comité de paix de Bambari, dans son bureau refait à neuf.
Jeunes inactifs
Dans un rapport fin novembre, la Banque mondiale exhorte le futur pouvoir à « diversifier » une économie « fortement dépendante de l’agriculture de subsistance » pour « sortir du piège de la fragilité et du cercle vicieux des violences ». La Centrafrique pointait fin 2018 au 188e rang mondial sur 189 de l’Indice de développement humain de l’ONU, et 71% de la population vivait en dessous du seuil international de pauvreté (moins de 1,60 euro par jour).
A Bambari comme dans tout le pays, les rues sont encore pleines de jeunes inactifs qui vivotent au jour le jour. « Si vous voyez un jeune qui se jette dans la rébellion, c’est par manque de boulot », estime Ousmane, commerçant d’un bazar poussiéreux du quartier musulman où s’entassent les marchandises venues de la capitale.
Le président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadera inaugure un centre de formation pour les jeunes à Bambari, en République centrafricaine, le 16 novembre 2020.
Le président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadera inaugure un centre de formation pour les jeunes à Bambari, en République centrafricaine, le 16 novembre 2020.
« Les quelques projets initiés par les ONG réduisent un peu le nombre de demandeurs d’emploi. Certains ont suivi des formations professionnelles, mais le chômage demeure », résume Abel Matchipata, maire de Bambari.
« Hormis la fragile société nationale sucrière et quelques succursales de téléphonie mobile, « il n’y a aucune grande entreprise ici », déplore-t-il. La ville peut bien s’enorgueillir de ses 3 km de route tout juste bitumés, il n’y passe que des véhicules humanitaires et des taxis-motos. Les camions des commerçants, eux, sont rares.
Les ONG restent les principales pourvoyeuses d’emplois. Mais les places sont chères et la plupart des personnels qualifiés viennent de Bangui.
Survivre
« Les ONG font beaucoup de projets mais il n’y pas de mécanisme qui permette de les pérenniser », déplore Jeannot Nguernendji. Certaines organisations dépendantes des bailleurs multiplient des projets parfois déconnectées de la réalité pour « survivre », confesse un de leurs responsables sous couvert d’anonymat.
Cela donne lieu à des scènes étonnantes. Comme cette sensibilisation au covid dispensée par une ONG internationale à des enfants en bas âge dans un pays où presque aucun adulte ne porte le masque. Ou ce 4×4 muni de haut-parleurs arpentant Bambari pour vanter la Journée internationale des latrines, dans l’indifférence générale.
Nombre de projets ont pourtant des résultats concrets: soutien aux petits commerces, forages, rénovation de bâtiments, panneaux solaires, sanitaires, distribution de vivres… Mais maintenant que la sécurité est revenue, c’est le risque de la dépendance à l’aide internationale qui guette.
A Bambari et alentours, les déplacés montrent peu d’empressement à quitter les sites gérés par les humanitaires pour rentrer chez eux malgré les aides au retour des agences onusiennes.
Au bord de la rivière Ouakka, le centre agropastoral installé par l’Organisation internationale des migrations (OIM) est une des rares opportunités pour les jeunes d’apprendre à cultiver la terre et d’échapper au désœuvrement.
Mais sur les 165 bénéficiaires au départ, beaucoup ont renoncé, découragés par la dureté du travail aux champs, selon le président du centre. « Les gens n’ont pas conscience, ils veulent seulement qu’on leur donne », se désole Ousmane.